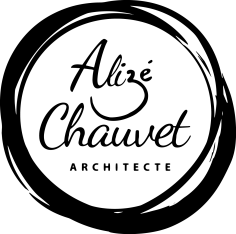Le monde change-t-il de couleur avec l’âge ?
Les couleurs sont partout. Elles teintent notre environnement, influencent nos choix et, de manière subtile mais puissante, façonnent notre humeur. Du rouge passionné au bleu apaisant, nous avons tous appris à associer certaines couleurs à des émotions spécifiques. Mais ces associations entre couleurs et émotions sont-elles gravées dans le marbre, ou évoluent-elles avec nous tout au long de notre vie ?
Cette question est essentielle en psychologie de la couleur et en neuroarchitecture, deux disciplines qui explorent comment la perception visuelle influence notre bien-être psychologique et notre rapport à l’espace.
Or, les personnes âgées passent souvent plus de temps à l’intérieur. Dans ce contexte, les couleurs de leur environnement quotidien pourraient avoir un impact significatif sur leur bien-être. Faut-il alors adapter les palettes de couleurs des espaces de vie en fonction de l’âge de leurs occupants ?
Pour répondre à cette question, une vaste étude interculturelle menée auprès de 7 393 participants de 16 à 88 ans dans 31 pays a exploré si notre lien entre les couleurs et les émotions change radicalement au cours de notre vie. Les résultats, à la fois attendus et surprenants, révèlent une histoire complexe sur la manière dont notre perception émotionnelle du monde se transforme, un fascinant paradoxe entre une stabilité quasi immuable et des changements subtils mais profonds.
Premier constat surprenant : Nos associations de couleurs sont remarquablement stables tout au long de la vie
Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, le résultat le plus frappant de l’étude est la similitude des associations entre couleurs et émotions à travers tous les âges. Qu’on ait 18 ou 80 ans, les schémas fondamentaux de ce que nous ressentons face à une couleur restent presque identiques.
Pour quantifier cette ressemblance, les chercheurs ont calculé un coefficient de similitude moyen de 0,97 entre les différents groupes d’âge (où 1,00 serait une identité parfaite). Cette stabilité confirme l’existence d’associations quasi universelles, profondément ancrées dans l’expérience humaine. Parmi les plus fréquentes, on retrouve :
• Rouge associé à l’amour (69,2 % des participants)
• Jaune associé à la joie (55,7 %)
• Noir associé à la tristesse (53,7 %)
• Rose associé à l’amour (53,2 %)
En réalité, l’étude a identifié pas moins de 14 associations si fréquentes qu’elles ont été choisies par plus de 40 % des participants, incluant également le rouge-colère (55,2 %), le gris-tristesse (47,7 %) et le blanc-soulagement (43,5 %). Cette constance est significative : elle renforce l’idée qu’il existe une base universelle dans la manière dont les humains relient le monde visible des couleurs à leur monde intérieur des émotions, une base qui transcende les décennies de notre existence.
Cette stabilité, observée dans des cultures et générations différentes, démontre que la perception émotionnelle des couleurs s’enracine profondément dans l’expérience humaine.


L’« effet de positivité » : Avec l’âge, nous voyons le monde avec des couleurs plus positives et intenses
Si les fondations de notre perception des couleurs sont immuables, les nuances, elles, se transforment avec le temps. La première de ces transformations est un glissement subtil mais profond vers l’optimisme. Le plus notable est ce que les chercheurs appellent l’« effet de positivité ». L’étude a révélé que les participants plus âgés avaient tendance à associer les couleurs à des émotions plus positives que leurs cadets.
Cette tendance s’accompagne d’une autre facette : les participants plus âgés ont également évalué l’intensité des émotions associées comme étant plus élevée. On pourrait résumer cette évolution par la formule : « Moins d’émotions, mais des émotions plus fortes et plus lumineuses ». En vieillissant, notre palette émotionnelle des couleurs semble se concentrer sur des sentiments plus vifs et plus optimistes.
Cette conclusion est l’un des points centraux de l’étude, comme le résument les auteurs :
Les participants plus âgés ont associé un plus petit nombre d’émotions, mais plus intenses et plus positives, à tous les termes de couleur, affichant un effet de positivité.
Moins, c’est plus : La spécificité émotionnelle s’affine avec l’âge
L’étude révèle aussi que les associations entre couleurs et émotions se simplifient avec l’âge. Alors qu’un adolescent pourrait lier le rouge à la fois à l’amour, la colère, la passion et l’énergie, une personne plus âgée fera des choix plus ciblés et plus affirmés.
Ce résultat suggère une spécificité et une certitude croissantes avec l’expérience de la vie. Les adolescents (16-19 ans) se situent à l’extrême opposé du spectre : ils sont le groupe qui associe le plus grand nombre d’émotions aux couleurs, mais ces émotions sont jugées comme les moins intenses et sont les moins biaisées positivement. Ce phénomène est le miroir inversé de l’« effet de positivité » observé chez les aînés: là où la vieillesse amène concentration, intensité et optimisme, l’adolescence se caractérise par une exploration émotionnelle large mais plus diffuse et moins assurée.
On observe donc un arc de développement au fil de la vie. Nos associations entre couleurs et émotions, d’abord diffuses et multiples à l’adolescence, deviennent progressivement plus raffinées, plus spécifiques et plus affirmées à mesure que nous vieillissons.


La perception de la puissance et de l’énergie des couleurs
Si la positivité générale augmente avec l’âge, notre perception de l’énergie (ce que les psychologues nomment l’« arousal », c’est-à-dire le niveau d’intensité et d’éveil d’une émotion, allant du calme à l’excitation) et de la puissance d’une couleur évolue de manière plus complexe et nuancée. Tout ne devient pas plus dynamique ; au contraire, une redistribution subtile s’opère.
L’étude met en lumière une dualité intéressante :
• Avec l’âge, les couleurs plus claires comme le turquoise et le blanc sont associées à un éventail d’émotions tendant davantage vers une haute énergie (arousal élevé) et une plus grande puissance.
• Inversement, les couleurs plus sombres comme le noir, le gris et le violet sont associées à des émotions tendant vers une plus faible énergie et une moindre puissance au fil du temps.
Le rouge est une exception notable à cette règle. Son association avec une forte énergie et une grande puissance reste remarquablement stable à travers tous les âges. Notre perception de la « vitalité » d’une couleur n’est donc pas statique. Elle évolue de manière discrète mais significative au fil des décennies, s’alignant de plus en plus sur la clarté et la positivité à mesure que nous vieillissons.
Applications pour la neuroarchitecture et le design émotionnel
Ces découvertes ont des implications directes pour la neuroarchitecture, discipline qui conçoit des espaces en fonction des réponses sensorielles et émotionnelles humaines.
En intégrant la psychologie de la couleur et la perception liée à l’âge, architectes et designers peuvent créer des environnements :
- plus positifs et stimulants pour les seniors,
- favorisant la sérénité et la stabilité émotionnelle,
- adaptés au vieillissement sensoriel (vision, contraste, luminosité, perception des teintes).
Les hôpitaux, maisons de retraite et espaces publics peuvent ainsi devenir de véritables architectures du bien-être, où la couleur agit comme un vecteur émotionnel et thérapeutique.
Conclusion : Voir la vie en rose… et en conscience
Nos émotions colorées évoluent avec l’âge : stables dans leurs fondations, mais plus positives, intenses et spécifiques au fil du temps.
Ces résultats rappellent que peindre un mur en jaune ne crée pas automatiquement de la joie, mais que la signification émotionnelle d’une couleur influence notre ressenti global d’un espace.
En intégrant ces connaissances dans la conception architecturale et sensorielle, il devient possible d’imaginer des lieux qui parlent au cerveau autant qu’au cœur, où chaque nuance contribue à l’harmonie émotionnelle des occupants.
En résumé : Avec l’âge, nos associations émotionnelles aux couleurs deviennent plus positives, plus intenses et plus ciblées. Cette découverte éclaire la neuroarchitecture et la conception des espaces dédiés au bien-être des seniors.
Source: Jonauskaite D, Epicoco D, Al-Rasheed AS, et al. A comparative analysis of colour-emotion associations in 16-88-year-old adults from 31 countries. Br J Psychol. 2024;115(2):275-305. doi:10.1111/bjop.12687