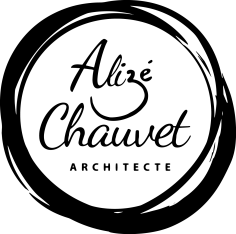L’aménagement intérieur pour les personnes neuroatypiques ne relève pas seulement de l’esthétique : il influence directement le bien-être, la concentration et les émotions. Pour les personnes neuroatypiques – qu’il s’agisse de profils TSA, TDA/H, DYS, HPI ou HPE… – ces impacts sensoriels sont encore plus marqués. Lumière, sons, textures, circulation… chaque détail compte. C’est là que la neuroarchitecture joue un rôle essentiel : en s’appuyant sur les neurosciences, elle permet de concevoir des espaces réellement inclusifs et apaisants, capables de s’adapter aux besoins variés de chacun.
1. Qu’est-ce que la neuroarchitecture ?
La neuroarchitecture n’est pas un style architectural : c’est une branche des neurosciences qui étudie l’impact des espaces sur notre cerveau et notre corps.
Elle observe comment des paramètres précis d’un espace comme la lumière, la forme, les textures ou les sons influencent notre physiologie, nos émotions et nos comportements.


2. Pourquoi la neuroarchitecture est essentielle pour les personnes neuroatypiques ?
Le terme neuroatypique regroupe de nombreux profils :
Troubles du Spectre Autistique (TSA)
Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H)
Troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, etc.)
Haut Potentiel Intellectuel (HPI)
Haut Potentiel Émotionnel (HPE)…
Ces personnes présentent souvent des particularités dans le traitement des informations sensorielles : hypersensibilité ou hyposensibilité aux sons, lumières, odeurs ou textures.
L’architecture, en agissant sur ces stimuli, peut soit améliorer leur qualité de vie, soit devenir une source de surcharge cognitive.
« Pour s’engager dans l’accompagnement de personnes autistes, il faut accepter de perdre tous ses repères habituels. C’est valable également pour les architectes. » Patrick Sadoun
3. Quels besoins spécifiques ces personnes ont-elles le plus souvent ?
Les besoins varient selon que la personne est en situation :
d’hypersensibilité : trop de stimulations deviennent envahissantes, ces personnes ont du mal à gérer un top grand nombre de stimulations sensorielles.
d’hyposensibilité : un manque de stimulations peut générer fatigue ou désengagement, ces personnes sont à a recherche de stimulations sensorielles pour se sentir bien.
Exemple : certaines personnes préfèrent des espaces visuellement épurés, d’autres recherchent au contraire des environnements stimulants (textures, couleurs, contrastes forts, repères).


Photo: Emmanuel Negroni, Agence d’architecture Negroni Archivision – Centre pour Autistes L’EVEIL DU SCARABEE
4. Quels éléments influencent le plus l’expérience sensorielle ?
L’expérience que nous faisons d’un espace est multisensorielle.
Les principaux facteurs et informations qui nous arrivent au travers de nos sens sont:
Lumière (naturelle et artificielle)
- Couleurs
Formes et proportions
Textures et matériaux
Sons et résonances
Odeurs
Température et qualité de l’air
Mouvements et circulation
Un équilibre harmonieux entre ces éléments permet de créer des environnements favorables aux personnes.
5. Les erreurs fréquentes dans l’aménagement des espaces
Les erreurs les plus courantes que mon peut trouver dans les aménagements d’espaces pour personnes neuroatypiques sont :
proposer des espaces rigides et uniformes,
ne pas offrir de choix aux occupants,
privilégier uniquement l’esthétique au détriment du confort sensoriel.
Résultat : ce sont les personnes qui doivent s’adapter au lieu, plutôt que l’espace s’adapte à elles.



Biblioteca da Escola Umbrella / Savana Lazaretti Arquitetura e Design Sensorial. Image © Renata Salles
6. Trois conseils pratiques pour les familles et les professionnels
Observer et comprendre les besoins réels de la/les personne/s pour qui ont conçoit l’espace : profil particulier, sensibilité sensorielle, âge, activités, moments d’occupation de l’espace, durée de présence.
Favoriser la diversité et la flexibilité : créer des alternatives au sein d’un même espace, éviter les espaces standardisés qui n’offrent pas d’alternatives possibles.
Ne pas croire qu’il faut un gros budget : la simplicité est souvent plus efficace que des solutions coûteuses et sophistiquées. Un espace bien pensé en amont peut tout a fait être adapté aux besoins spécifiques de personnes neuroatypiques sans pour autant que cela fasse exploser le budget.
Conclusion
La neuroarchitecture nous rappelle une évidence : l’espace influence profondément nos émotions et nos comportements.
Pour les personnes neuroatypiques, adapter les environnements devient un véritable levier d’inclusion, de bien-être quotidien et de santé.
Concevoir des espaces sensoriellement adaptés, c’est offrir à chacun la possibilité de se sentir bien, accueilli et respecté.
N’hésitez pas à partager cet article auprès de professionnels ou de personnes vivant auprès de personnes aux besoins sensoriels et neuro atypiques!