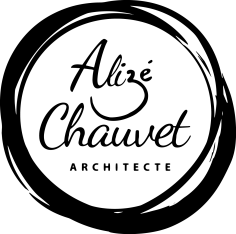Introduction Neuro-architecture
Notre bien-être ne dépend pas seulement de ce qui se passe en nous, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas « coupés » de notre environnement et comme un poisson dans l’eau, les espaces dans lesquels nous vivons influencent notre santé et notre bien-être physiologique, psychologique et émotionnel.
Ma rencontre avec la Neuroarchitecture m’a ouverte à une approche holistique du bien-être : Les études scientifiques mettent en évidence la relation constante entre l’environnement et la personne.
La conception consciente des espaces intérieurs a le pouvoir d’optimiser cette interaction grâce à la neuroarchitecture.


1. Pourquoi l’agencement des espaces dans lesquels nous vivons est-elle si importante?
L’architecture ne se contente plus de créer de simples espaces fonctionnels. Aujourd’hui, nous comprenons que notre bien-être dépend étroitement de notre environnement. Cette prise de conscience s’appuie sur deux grands constats :
L’impact de l’environnement sur l’humain
Nos espaces de vie, de travail ou de loisirs influencent notre humeur, notre concentration et même notre santé physique. Des éléments aussi variés que la lumière, la couleur, le son ou encore la qualité de l’air jouent un rôle crucial dans notre quotidien. Cette interaction, souvent inconsciente, révèle que l’espace n’est pas neutre : il est un véritable acteur de notre bien-être et agit sur nous continuellement.
Les avancées de la neuroarchitecture
La neuroarchitecture se base sur les découvertes des neurosciences pour comprendre comment l’environnement agit sur notre cerveau, notre corps et nos comportements. En plaçant l’humain au centre du processus de conception, cette approche vise à créer des espaces qui stimulent positivement nos sens et réduisent le stress. Elle nous montre que des aménagements bien pensés peuvent favoriser l’apprentissage, la créativité, la détente… Vivre dans des espaces adaptés à nos besoins physiologiques primaires ont un effet à long terme sur notre bien-être et notre santé (sommeil, stress, cycles hormonaux, régulation du système nerveux…)
Ces constats nous invitent à repenser notre manière de concevoir les espaces. L’enjeu est de taille : il s’agit de transformer nos environnements pour qu’ils soutiennent pleinement notre santé et notre épanouissement.


2. Comment créer des espaces qui favorisent le bien-être?
Prendre en compte les « aspects visibles » et « non visibles » des espaces
- Ce qui se voit : C’est la partie la plus évidente, car elle est visible à l’oeil nu. Il s’agit des aspects de l’environnement comme la lumière, les couleurs, les matériaux, la pollution visuelle, les éléments de décoration, etc…
- Ce qui ne se voit : C’est la partie cachée de l’iceberg, ce qui n’est pas visible par notre oeil. Il s’agit des aspects d’éléments comme la qualité de l’air, les odeurs, la température, les sons, les textures des surfaces, les ondes, les ambiances, etc.
Cette dualité rappelle que notre ressenti dépend autant de ce que l’on perçoit consciemment que de ce qui agit de manière plus subtile sur nos sens et notre physiologie.
Prendre en compte les 3 besoins fondamentaux des personnes
- Besoins Physiologiques : Ce sont nos besoins de base, ceux qui représentent la base de la pyramide de Maslow. Si ces besoins physiologiques n’étaient pas comblés nous ne pourrions tout simplement pas vivre: manger, boire, dormir, respirer, bouger.
- Besoins Socio-émotionnels : Il s’agit de la relation à soi, aux autres et à notre environnement.
- Besoins Cognitifs : Ils sont essentiels pour stimuler notre cerveau et maintenir nos facultés intellectuelles. Il s’agit de la perception, l’attention, la mémoire et l’interprétation.
Lorsque ces trois dimensions (Physiologique, socio-émotionnelle et cognitive) sont soutenues par un environnement adapté, l’individu peut évoluer de manière plus saine et épanouie.
Prendre en compte les Échanges Constants : Environnement ↔ Personne
Il existe une interaction permanente entre l’environnement et la personne. Chaque changement dans l’environnement (modification de la luminosité, du bruit, de la température, etc.) peut entraîner une réponse physiologique ou psychologique chez l’individu (libération de certaines hormones comme la dopamine, l’adrénaline ou le cortisol).
Dans un même temps, les besoins de la personne (repos, créativité, socialisation) peuvent motiver des ajustements dans l’espace (reconfiguration du mobilier, ajout de connexion à la nature (biophilie), régulation de la lumière, etc.). C’est l’étude de ce dialogue perpétuel qui constitue la base des recherches en neuroarchitecture.
3. Neuroarchitecture : Quand la Science S’invite dans la Conception architecturale
Les projets basés sur les connaissances en neuroarchitecture visent à concevoir des espaces en s’appuyant sur les neurosciences, afin d’améliorer le bien-être global. Comment ? En étudiant la manière dont notre cerveau perçoit et réagit aux stimuli que nos sens lui envoient quand notre corps entre en interaction avec son environnement. Les architectes et designers peuvent alors mener des actions concrètes pour modifier l’environnement bâti. Voici quelques exemples concrets d’actions qui peuvent être menées:
- Adapter la lumière (naturelle et artificielle) pour respecter notre rythme circadien et respecter l’équilibre de notre système nerveux.
- Sélectionner les couleurs et les matières qui stimulent ou apaisent, selon les besoins.
- Optimiser l’acoustique pour réduire le stress et améliorer la concentration dans les espaces qui le nécessitent.
- Introduire un lien la nature (plantes, vue sur l’extérieur, matériaux naturels) afin de favoriser la détente et la régénération cognitive.
- Adapter les espaces d’apprentissage en fonction de l’état d’évolution du cerveau des élèves.
- Favoriser le sommeil et la récupération en créant une architecture propice au repos…
4. Vers un Équilibre Corps-Esprit-Environnement
En plaçant l’humain au cœur du projet, la neuroarchitecture propose une approche intégrative :
- Santé physique : Encourager le mouvement, le repos et la respiration, nos besoins de base.
- Santé émotionnelle : Réduire le stress, favoriser la relaxation, l’échange, la connexion à soi.
- Santé cognitive : Stimuler l’attention, la créativité et la concentration.
L’environnement devient alors un partenaire de notre équilibre global et non plus un simple décor.
5. Conclusion : Saisir la Globalité du Bien-Être
Le bien-être est un concept complexe et multidimensionnel. En prenant en compte à la fois l’environnement visible, l’environnement invisible et les besoins holistiques de la personne, nous pouvons créer des espaces qui nourrissent le corps, l’esprit et l’âme. Cet équilibre général nous permet de vivre notre vie de la meilleure façon qui soit et de prévenir d’éventuels déséquilibres physiologiques, émotionnels et cognitifs.
La neuroarchitecture offre ainsi un cadre passionnant pour réinventer nos lieux de vie, de travail, d’étude, de santé et de loisir, en veillant à ce qu’ils soutiennent réellement notre bien-être global. C’est en comprenant les échanges constants entre l’environnement et l’individu que nous pourrons concevoir des espaces plus humains, plus vivants et plus respectueux de notre santé.